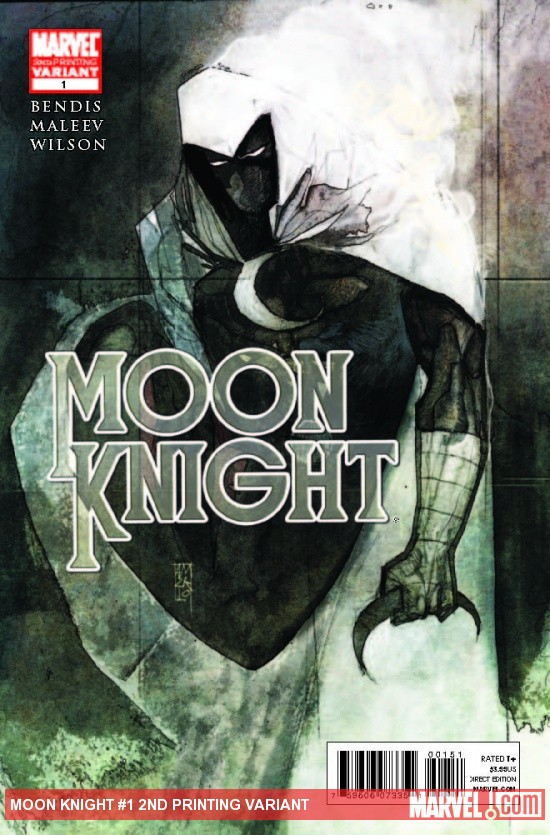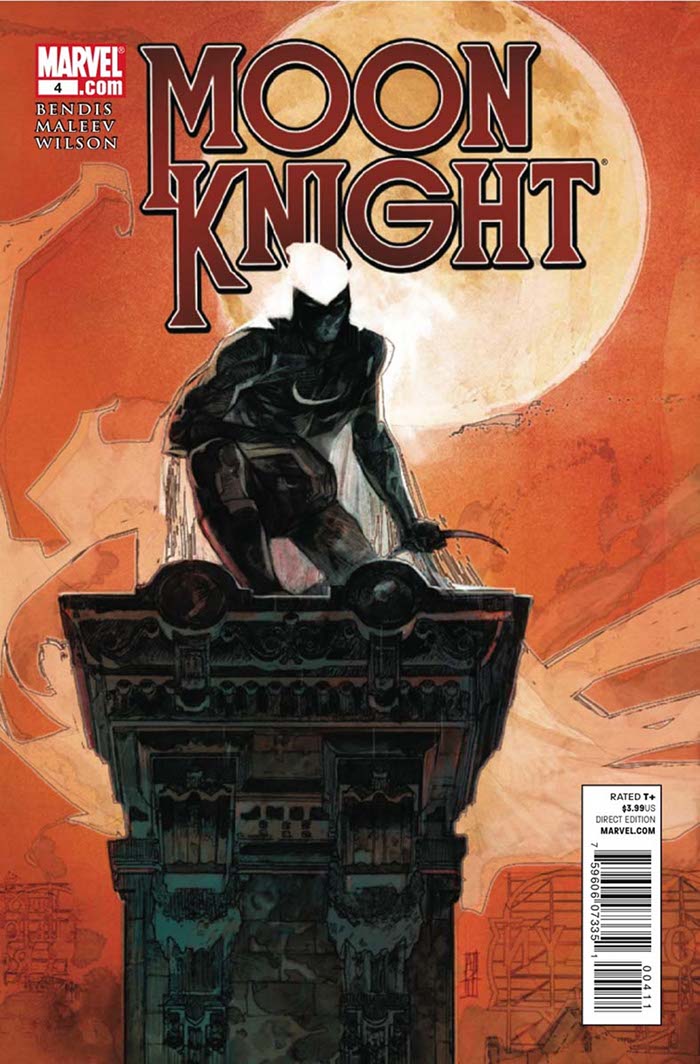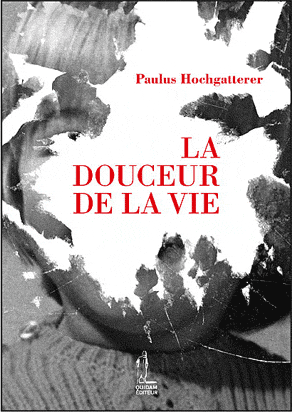Le samedi 9 juin, nous accueillions Maylis de Kerangal, de virée provençale dans le cadre des rencontres littéraires organisées par l'association Initiales. Même si Préambule n'était pas partie prenante de l'évènement, l'occasion était trop belle pour la laisser passer et notre librairie a ainsi pu bénéficier de la présence de l'écrivain pour une rencontre/signature dans les rues cassidennes. Si le soleil a été en partie au rendez-vous, difficile d'en dire autant pour nos lectrices et lecteurs qui n'auront guère profité de l'honneur qui nous était accordé.
Une fois les présentations faites à la librairie marseillaise de l'Histoire de l'oeil où nous devions retrouver Maylis de Kerangal, la discussion s'engage dans la voiture. Passés les traditionnels et banals éléments introductifs, nous nous dirigeons peu à peu sur l'actualité littéraire de l'écrivain, et sur les processus de création de son dernier ouvrage Pierre feuille ciseaux. Alors que nous venons de discourir autour des protagonistes archétypaux qu'elle a construits dans son texte sur la banlieue parisienne, je me décide enfin à ouvrir mon dictaphone. Je vous propose donc la retranscription de cet entretien impromptu, conduit entre Marseille et Cassis.
Préambule : Avec vos deux derniers
ouvrages, Tangente vers l’Est et Pierre feuille ciseaux, on retrouve une
certaine ligne directrice avec Naissance d’un Pont, et je voulais donc savoir
si vous vous considérez comme un écrivain de l’environnement, en tout un cas un
écrivain de l’espace ?
Maylis de Kerangal : Pas un
écrivain de l’environnement au sens où l’environnement comme thème écologique
qui n’est pas mon geste. En revanche, j’espère effectivement travailler les
espaces, la saisie des territoires, les mouvements, l’inscription physique des
êtres dans des lieux. Et je conçois un peu les livres comme des écosystèmes.
Par exemple, pour moi, Pierre feuille ciseaux, c’est une forme d’écosystème.
P : Oui, c’est plus dans ce
sens-là que j’entendais le mot géographique, au sens géographique, de milieu
donné, dans lequel vont ensuite évoluer les personnages.
MdK : Oui, voilà, c’est ça.
Maintenant dans le Pont, il y a quelques biais écologiques.
P : Mais ça reste
secondaire. Il y a l’anthropologue…
MdK : Oui voilà, c’est ça,
il y a aussi les oiseaux. Mais ce n’est pas mon geste même si je peux avoir des
préoccupations comme toute citoyenne.
P : Alors en parlant du
Pont, on pourrait le voir comme une explosion des routines, qu’elles soient
urbaines et sociales alors que dans le Transsibérien ou les cités de banlieue
que vous décrivez, vous explorez plutôt les notions de marge, de frontières, de
zones-tampon. Est-ce que vous êtes passée de l’étude de l’espace perturbé dans
Naissance d’un Pont à l’espace qui perturbe dans les deux autres ?
MdK : J’ai l’impression en
tout cas que ce que j’essaye d’étudier c’est les veines de la crise. Et c’est
vrai que le Pont c’est un espace en crise, crise de croissance, crise du
territoire, reconfiguration des spéculations. On décide de faire un pont,
qu’est-ce qu’il se passe etc… Autant dans les deux autres, ce qui m’intéresse,
c’est aussi de voir comment la crise traverse ces espaces. Notamment dans
Pierre feuille ciseaux où finalement le regard est porté sur des terrains qui
cumulent tous les marqueurs négatifs des communautés urbaines. Stains c’est
assez fort sur ce plan-là, pour autant j’espère avoir évité le regard
stigmatisant, ou en tout cas le regard des clichés journalistiques de la fille
du Centre qui vient dans la Périphérie. Je dis en revanche que c’est plutôt
comment la crise travaille ces lieux, qui est aussi une crise des
représentations. Ça, ça m’a vachement intéressée. Pour moi, la perturbation
elle est aussi au niveau des représentations. Parce que pour le coup, quand on
dit Stains… vous savez que les habitants de Stains, en tout cas ceux que j’ai
rencontrés, étaient traumatisés de leurs cités. C’était une souffrance pour eux
quand même… On ne s’en rend pas bien compte, mais il y a une crise de
représentation des banlieues. Ça devient un topos archétypal, alors qu’il y a
quand même des réalités extrêmement différentes.
P : Cela dit avec le garçon
de la cité que vous décrivez, on est un peu dans l’ambiguïté. Dans la première
partie il est effectivement dans la fermeture, et même une fermeture de plus en
plus affirmée, et c’est ensuite une rencontre qui le fait sortir de son
territoire, puis encore plus, dans Paris intra-muros.
Mdk : Oui. Une sorte de
retour vers le Centre. Enfin disons plutôt que plus qu’un retour vers le Centre,
il y a une appropriation du Monde. Il y a effectivement un décloisonnement qui
est ici lié à l’amour ou au désir qui rend les frontières poreuses. Alors c’est
une idée… ça vaut ce que ça vaut, mais c’est l’idée qu’il peut y avoir des
dépassements, ici liés au désir, mais où en tout cas, la sensation devient plus
forte. Mais ça me permettait de dire que ces adolescents, que je n’ai
évidemment pas fréquentés, mais avec lesquels j’ai passé pas mal de temps pour
être juste, qui me paraissaient extrêmement clos dans leurs représentations,
celle de Paris, celle de la femme qui vient de Paris, l’écrivain qui est une
femme qui vient de Paris. Et en même temps ils étaient assez tentés par le
décloisonnement, c’est-à-dire que les choses sont beaucoup plus plastiques
qu’on ne le croit. Ce livre aimerait montrer que l’exploration des marges, des
lisières, des frontières, ces zones traversées par la crise, ces espaces
perturbés, montrent aussi finalement une plasticité du réel.
P : Vous me donnez un peu ma
transition sur le traitement que vous accordez à vos personnages, et qui me
semble être un antipsychologisme. J’aurais même plutôt l’impression que dans
vos romans on se retrouverait face à une éthologie des interactions humaines là
encore configurées par les espaces que vous décrivez et qui priment sur les
motivations individuelles ou psychologiques.
MdK : Alors, en fait, je
suis passée par un parcours d’auteur où la psychologie, ou en tout cas,
l’écriture psychologique, c’est-à-dire sourcée par l’examen, l’introspection,
l’examen des psychés, était un peu une figure imposée du roman. Et c’est aussi
une conversion du regard. Mais ce n’est pas un rejet de la psychologie, puisque
par ailleurs, je trouve que la psychologie c’est passionnant. Je n’ai pas ce
rejet de « la psychologie c’est chiant, c’est mal ». C’est surtout la
littérature qui serait entièrement vectorisée par la psychologie qui, je trouve, a du mal à se démarquer de l’explication. C’est comme si le lecteur
avait une explication et que du coup, l’auteur était en position d’expliquer le
réel. Et ce n’est pas du tout mon geste. Là où je me situe, là où je mets
toutes mes billes, c’est dans la description. C’est une forme de captation du
réel que j’essaye d’organiser avec les moyens qui sont les miens, mais à un
moment donné, je trouvais que ce n’était plus juste d’être dans un discours
analytique, explicatif sur les motivations psychologiques et les intentions des
personnages. Il m’a semblé beaucoup plus juste que la psychologie, l’intériorité,
émanent des personnages à travers les mouvements, la physiologie, les corps.
P : Je me disais d’ailleurs
qu’il y a avait presque de la physique dans vos textes.
MdK : Oui. L’idée c’est que
la psychologie a forcément une traduction physiologique. Comme le yaourt, « ce
qui se mange à l’intérieur se voit à l’extérieur ». Il y a quelque chose
de l’ordre de la phénoménologie, c’est-à-dire on le voit, on le capte et on
peut le décrire. Et la littérature peut se saisir de ça de façon assez frontale
et assez juste, pour peu qu’il y ait une éthique de l’auteur. C’est-à-dire moi
je décris, et ce faisant je prends du surplomb sur ce que je mets en place, et
là je mets toutes mes billes dans la description, et j’active tout ce que je
peux pour être en quelque sorte une médiatrice. Et cela me semble être plus
juste que toujours être dans l’idée d’écrire en disant au lecteur « voilà
c’est comme ça, et en faisant ou en disant ça, il se rappelait que ça, il se
demandait si à ce moment-là si, etc… ». Parfois, je pense qu’un geste, un
mouvement, une intonation, porte les intentions. Et ça, c’est de l’ordre de la
phénoménologie.
P : Cela me fait d’ailleurs
penser que souvent les personnages que vous rapprochez, que ce soit le chef de
chantier et Catherine dans Naissance d’un Pont, ou Aliocha et Hélène dans
Tangente vers l’Est ne peuvent s’exprimer dans le registre de l’intime du fait
des barrières, qu’elles soient sociales ou même linguistiques.
MdK : L’idée c’est toujours
que les corps sont les messagers des gestes, ce sont les porte-parole des psychés.
Les corps sont les messagers d’intériorités. Et ce qui me plaît là-dedans, c’est
que c’est une inversion des valeurs. C’est contre-intuitif, parce qu’on est
quand même dans un logique du caché, c’est-à-dire qu’on cherche, l’apparence
est toujours suspecte, les corps, la peau, la surface. L’expression « c’est
superficiel » le dit bien. C’est l’idée qu’on est dans quelque chose de
dépréciatif, dans ce que l’on voit, il y a une illusion. La source, la vérité
des êtres, elle est à l’intérieur. Moi j’essaye de renverser, de retourner la
médaille. C’est-à-dire que je pense qu’on
a une lecture du réel, du sensible, qui nous informe déjà beaucoup sur l’idée qu’il
y ait des petits secrets, qu’il y ait du caché, qu’on nous ment. Mais par
exemple, dans la rencontre entre Catherine et Diderot, rien que la façon qu’ils
ont de se tenir, l’un vis-à-vis de l’autre,
d’éviter de se parler, ça va très très vite, et je pense que, décrivant cela, j’évite
de rentrer dans l’histoire de ces deux êtres qui sont en train de tomber
amoureux. C’est plutôt du registre déductif. En fait, j’essaye de me mettre à
la place du lecteur, je suis une lectrice, et moi c’est la lecture du réel qui
me porte.
P : D’ailleurs cela reste
souvent à un certain niveau d’abstraction. Il y a beaucoup de clefs que vous
laissez au lecteur. Il y a souvent des blancs, et c’est à lui de reconstituer
les éléments.
MdK : Oui, j’essaye d’être
assez précise, mais c’est vrai qu’il y a des blancs. Et évidemment il y a des
blancs, et ce qu’il y a derrière la porte. N’y ayant pas accès, je ne le décris
pas. Mais moi, ce qui me touche aussi c’est qu’au-delà d’une position que je
trouve juste… par ailleurs, quand je lis Mrs Dalloway, je vois bien s’il
fallait tenir un roman par un point d’intériorité, c’est un truc extrêmement
géant. C’est génial de faire ça. Je ne fais pas un rejet de ça, mais
précisément je m’en sens incapable. Ce n’est pas mon geste actuellement. Je n’ai
pas un rejet « la psychologie c’est nul, la psychologie c’est naze ».
Moi pour l’instant, déjà je décris, et ce que je donne c’est ça. Et je mets
déjà beaucoup de choses là-dedans. Après c’est le statut supérieur de l’intériorité
qui m’agace. Pour moi, le premier monde, ce n’est peut-être pas le monde de la
pensée. Ce n’est peut-être pas le monde de l’introspection. Le premier monde, c’est
le monde de la sensation. C’est aussi bête que ça, c’est l’idée que toucher,
voir, sentir, cette façon d’être au monde, elle me rend sur ce que c’est que le
vivant, pour moi. Et mes livres sont un petit peu organisés comme cela. Aliocha
et Hélène, il y a des gestes, mais finalement si ces gestes sont décrits à
bonne vitesse, on sait ce qui se passe, les intentions sont là et de fait, l’intériorité
est aussi présente.
P : Pour revenir à vos
personnages de Tangente vers l’Est, il est vrai que dès les premières pages, on
sent que l’univers militaire n’est pas fait pour Aliocha. L’idée est rapidement
assimilée, pas besoin de quarante ou cinquante pages pour l’étayer. Pareil il
me semble pour Hélène, où le rejet de la Française qui fuit son amant est
rapidement évoqué, pas besoin de s’alourdir beaucoup plus.
MdK : Et là pour le coup, c’est
vrai que les motivations d’Hélène, pourquoi elle quitte Anton, c’est presque un
autre livre. Ça, ça m’intéresse pas trop, et c’est aussi le fait que le lecteur
peut comprendre qu’elle a suivi son amant en Sibérie, elle aime encore
probablement cet homme, en tout cas elle n’en est pas encore séparée. En
revanche ce pays-là elle s’y sent mal, et elle s’en va. Et là je me dis que le
lecteur a peu d’éléments, mais il a aussi de quoi tracer son histoire, son
récit.
Un grand merci à Maylis de Kerangal, à son extrême gentillesse et continuelle disponibilité.
PS : j'espère que cet entretien vous aura donné envie de découvrir la plume d'un des écrivains contemporains les plus enthousiasmants sur le plan littéraire, et des plus attachants humainement.
 J'apprécie énormément la veine westernienne dans laquelle s'inscrit Garth Ennis. Dans Streets of Glory, nous sommes en 1899, un tournant dans la mythologie du Far-West, qui correspond à l'arrivée du train, la fin d'un monde et le remplacement des grands tireurs par des administratifs. Pour les joueurs de jeux vidéo, cet album rappelle le contexte de Red Dead Redemption, dans ce Far-West qui se meurt lentement et doit peu à peu s'effacer dans la poussière devant le XXe siècle. On est donc entre nostalgie et désenchantement, le petite histoire et la grande, l'héroïsme et l'anodin. Un entre-deux qui laisse toujours un goût particulier à la lecture. En tout cas on sent que Ennis est plutôt confortable avec ce registre, et ses dialogues sont encore une fois plutôt bien écrits. Cela dit, cela reste du Ennis, et ne vous attendez-pas à de la finesse. C'est du Avatar assumé, ça tire, ça tue, ça torture, ça mutile, et ça le montre. Le scénariste est plutôt amateur de la violence explicite dans un contexte qui le justifie, et on sent qu'il a eu carte blanche. Comme d'habitude, via ce vétéran des guerres indiennes, on retrouve les marottes de l'Irlandais sur l'armée, l'importance de la guerre et de ses conséquences sur la psyché des personnages. Une petite quenelle glissée au passage sur les Américains dans leur traitement des locaux, pas de doute, c'est du Ennis tout craché.
J'apprécie énormément la veine westernienne dans laquelle s'inscrit Garth Ennis. Dans Streets of Glory, nous sommes en 1899, un tournant dans la mythologie du Far-West, qui correspond à l'arrivée du train, la fin d'un monde et le remplacement des grands tireurs par des administratifs. Pour les joueurs de jeux vidéo, cet album rappelle le contexte de Red Dead Redemption, dans ce Far-West qui se meurt lentement et doit peu à peu s'effacer dans la poussière devant le XXe siècle. On est donc entre nostalgie et désenchantement, le petite histoire et la grande, l'héroïsme et l'anodin. Un entre-deux qui laisse toujours un goût particulier à la lecture. En tout cas on sent que Ennis est plutôt confortable avec ce registre, et ses dialogues sont encore une fois plutôt bien écrits. Cela dit, cela reste du Ennis, et ne vous attendez-pas à de la finesse. C'est du Avatar assumé, ça tire, ça tue, ça torture, ça mutile, et ça le montre. Le scénariste est plutôt amateur de la violence explicite dans un contexte qui le justifie, et on sent qu'il a eu carte blanche. Comme d'habitude, via ce vétéran des guerres indiennes, on retrouve les marottes de l'Irlandais sur l'armée, l'importance de la guerre et de ses conséquences sur la psyché des personnages. Une petite quenelle glissée au passage sur les Américains dans leur traitement des locaux, pas de doute, c'est du Ennis tout craché.